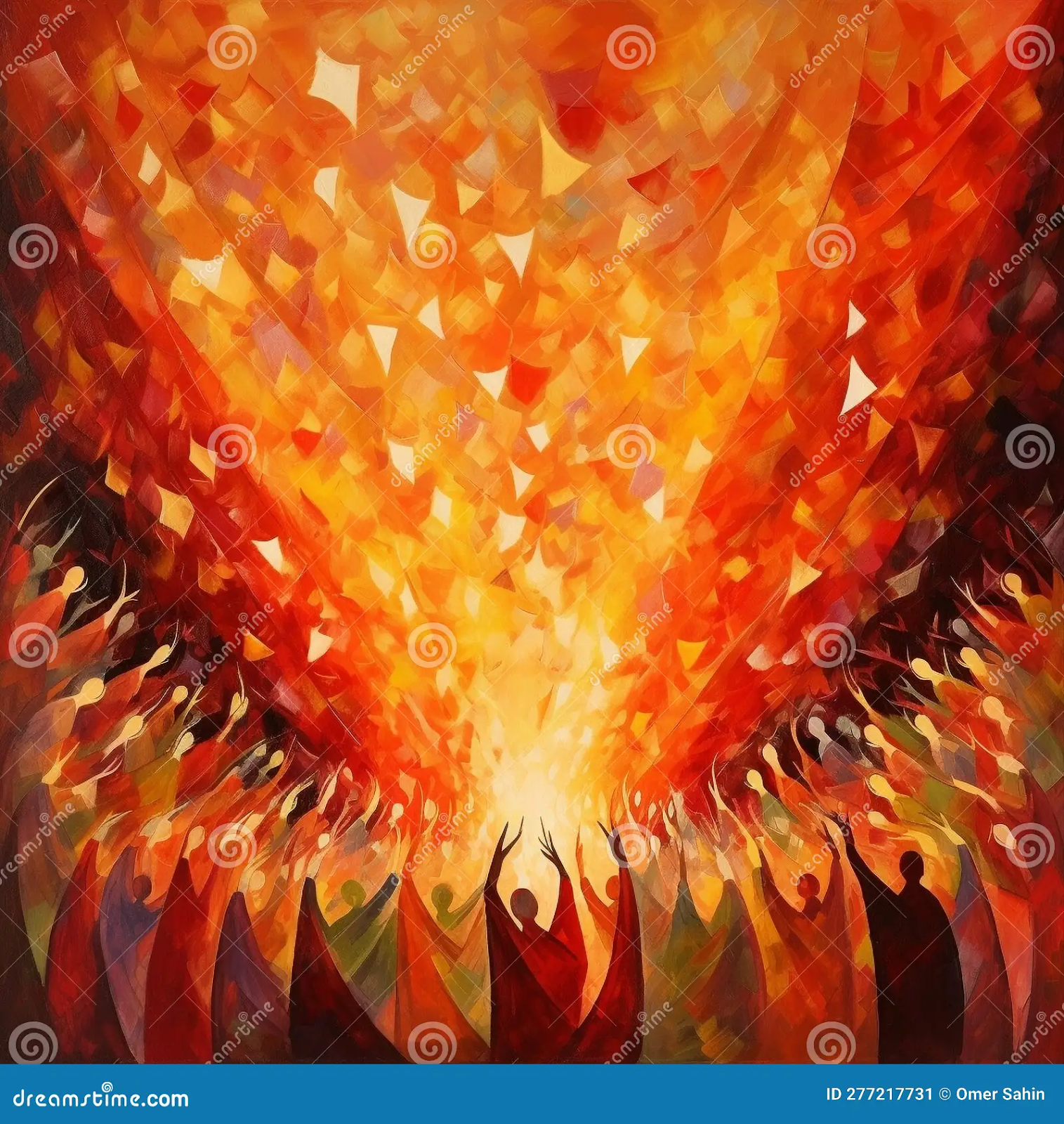« qui est Seigneur
et qui donne la vie »
(Symbole de
Nicée-Constantinople)
L’Esprit Saint comme Personne divine est toujours à redécouvrir
Il fallut attendre le pape Léon XIII qui insista
dans un document de 1897 sur la prière au Saint-Esprit. Le concile Vatican II
dans les années 60 pouvait alors lui donner toute sa place en utilisant
notamment le titre « Temple de l’Esprit » pour désigner l’Eglise.
Mais pour beaucoup de chrétiens encore aujourd’hui,
le Saint-Esprit reste un inconnu, le « Divin Méconnu » selon le
Cardinal Yves Congar.
Force divine ? Présence spirituelle de
Dieu ? Souffle de renouveau ? Les termes ne manquent pas, mais ils
révèlent la difficulté que nous avons d’en parler.
Ces expressions vagues peuvent également exprimer la
difficulté d’accueillir l’affirmation du Symbole de foi : « je
crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie. »
Nous sommes invités à dire je crois en
l’Esprit Saint, au même titre que nous disons je crois en Dieu le Père et en
son Fils Jésus-Christ. L’Esprit Saint est une Personne divine en qui nous
sommes appelés à croire et que nous pouvons prier.
Ces
dons reçus de l’Esprit de Dieu sont encore nos talents et nos charismes qui se
déploient pleinement en servant le projet de Dieu pour l’humanité. Nous voyons
dans le groupe des disciples ; devant la découverte du tombeau vide,
Madeleine, Pierre et Jean réagissent différemment selon leur tempérament et
leurs talents, l’un plus courageux, l’autre plus prudent, l’un plus intuitif,
l’autre plus rationnel… Mais tous cheminent dans la foi, et à partir de la
Pentecôte ils témoigneront de la résurrection du Christ en bravant les
barrières sociales et culturelles.
L’Esprit
Saint est ainsi le dispensateur des dons pour la croissance humaine et
spirituelle de chaque personne, mais il est encore davantage : il est
Dieu, comme l’atteste Jésus lui-même.
L’Esprit
Saint est la troisième Personne de la Trinité qui atteste que Dieu vit au plus
profond de lui-même une relation d’amour et d’unité, relation qu’il veut
partager à toute l’humanité. L’Esprit-Saint disait Jean-Paul II, c’est Dieu qui
se donne (Encyclique sur l’Esprit Saint, Dominum et vivificantem
1986).
Ainsi
le récit de la Pentecôte évoque les langues de feu pour signifier que l’Esprit
est comme le feu qui brûle les cœurs de l’amour même de Dieu.
Jésus
disait d’ailleurs en annonçant sa mort et sa résurrection : « Je suis
venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu’il fût déjà
allumé ! » (Lc 12,49). La communauté des apôtres va être brûlée de
cet amour et établie dans une unité profonde.
A
l’époque, l’avocat se tenait à côté de l’accusé et lui soufflait les paroles
pour sa défense.
Ainsi
à la Pentecôte, l’Esprit se manifeste comme un souffle qui secoue et pousse les
apôtres en-dehors de la maison où ils se trouvent. A la suite de saint Pierre,
les apôtres se mettent alors à annoncer dans toutes les langues la Bonne
Nouvelle de Jésus Ressuscité. Les apôtres ne se sentent plus orphelins, mais
habités par une présence, celle de Jésus Ressuscité Lui-même. L’Esprit réalise
la promesse inouïe de Jésus : « Et moi, je serai avec vous tous les
jours jusqu’à la fin des temps ! » (Mt 28,20).
Il
nous est donné d’une manière nouvelle comme un souffle, à la confirmation pour
nous entraîner sur le chemin du témoignage.
Nous
pourrions dire que par le baptême, l’Esprit Saint nous greffe sur la vie du
Christ et par la confirmation, il nous fait participer à la mission du Christ.
Devenir fils et fille de Dieu par le Baptême, c’est manifester au grand jour ce qui était déjà inscrit dans notre vie par la création. Dieu est lié à chaque être humain. Le Baptême l’affirme et le réalise explicitement. Il nous donne d’accueillir personnellement la parole que Dieu a adressée à Jésus lors de son Baptême par Jean : «Tu es mon fils bien-aimé ! ».
Si la vocation baptismale est une consécration à
Dieu, elle est également une mission. Au moment de l’onction du Saint-Chrême,
qui signifie le don de l’Esprit Saint et annonce la confirmation, le célébrant
dit : « Désormais, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa
dignité de prêtre, de prophète et de roi ».
Pour
saint Athanase, le grand défenseur de la foi en Dieu Trinité, la Pentecôte
était la finalité de la venue du Fils de Dieu en cette terre : « Le Verbe
a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l’Esprit Saint. Dieu s’est
fait porteur de la chair pour que l’homme puisse devenir porteur de
l’Esprit » (Discours sur
l'incarnation du Verbe). Porteur de l’Esprit Saint, c’est laisser développer en
nous les dons de Dieu, c’est laisser Dieu agir en nous.